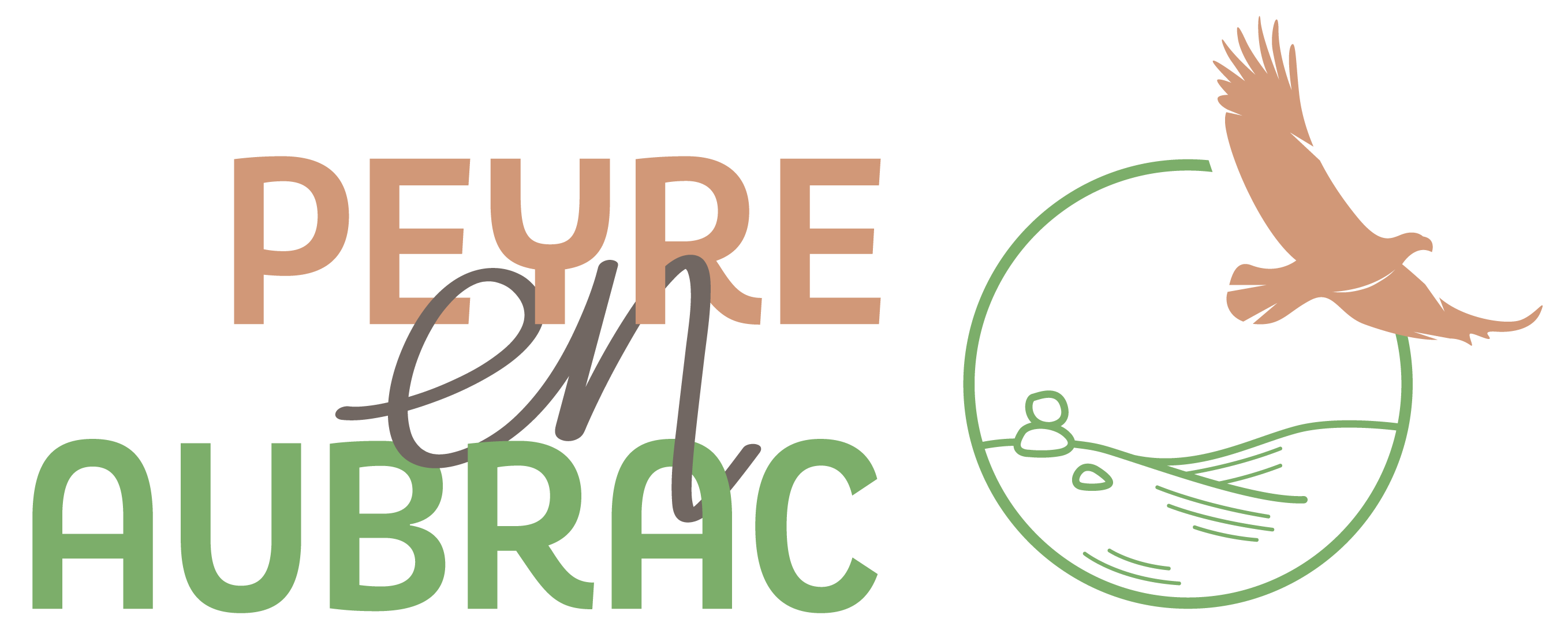C’est quoi le PLU d’une commune ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme et fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation des sols.
Déposer une observation ou une demande concernant le Plan Local d’Urbanisme : c’est ici !
Diaporama de la réunion publique de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : c’est ici !

Pourquoi élaborer un PLU ?
Le Conseil municipal de PEYRE-EN-AUBRAC a décidé, par délibération du 9 octobre 2024, de prescrire l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Plus concrètement, la commune s’est fixé les objectifs suivants :
Conforter le cadre et la qualité de vie des habitants :
- Soutenir les fonctions économiques et de services de la centralité d’Aumont-Aubrac, indispensables aux besoins courants de la population résidant dans le pôle, mais aussi dans les espaces ruraux, en s’appuyant sur les dispositifs existants (village d’Avenir…) ;
- Diversifier l’offre de logements afin de proposer un parcours résidentiel complet sur le territoire et ainsi répondre à un enjeu de mixité sociale et intergénérationnelle ;
- Contribuer à la mise en valeur et préservation du patrimoine bâti remarquable et/ou caractéristique du territoire.
Maîtriser le développement économique pour pérenniser et favoriser les emplois sur le territoire communal :
- Veiller à l’équilibre commercial entre commerces de centre-bourg et zones commerciales périphériques ;
- Conforter les zones d’activités artisanales et industrielles existantes ;
- Conforter la vocation agricole du territoire, encourager la diversification agricole et le développement des circuits courts alimentaires.
Préserver et valoriser le potentiel environnemental et paysager :
- Augmenter la durabilité du territoire, à travers la préservation des ressources naturelles, patrimoniales et paysagères, la promotion d’une agriculture résiliente, le respect des trames vertes et bleues, le déploiement des mobilités douces et alternatives… ;
- Préserver et optimiser l’utilisation de la ressource en eau ;
- Concourir à adapter le territoire, les activités et les infrastructures au changement climatique et aux enjeux énergétiques de demain : développement des énergies renouvelables, des mobilités actives…
Tenir compte des documents de rang supérieur tels que le SRADDET Occitanie, la Charte du PNR Aubrac, le SDAGE, SAGE… qui s’imposent au PLU, et prendre en compte les dispositions de la Loi Montagne
Se mettre en cohérence avec les nouvelles obligations réglementaires en matière d’urbanisme et d’habitat, en particulier la loi Climat & Résilience qui fixe de nouveaux objectifs liés à la sobriété foncière et à la lutte contre l’artificialisation des sols. Pour mener à bien l’élaboration du PLU, la commune sera accompagnée par le bureau d’études CAMPUS Développement, expert en matière d’urbanisme réglementaire dans les territoires ruraux.

4 grandes étapes incontournables

Démarche et calendrier prévisionnel

- Diagnostic territorial
- Etat initial de l’environnement
- Définition des enjeux
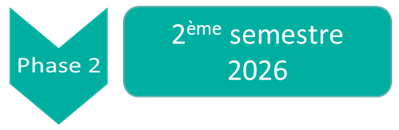
• Elaboration du PADD (Plan d’Aménagement et De Développement)
Orientations générales des politiques d’aménagement

- Traduction réglementaire du PLU
- Définition des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)
- Elaboration du règlement écrit et graphique (plan de zonage)
- Formalisation du dossier d’arrêt du PLU
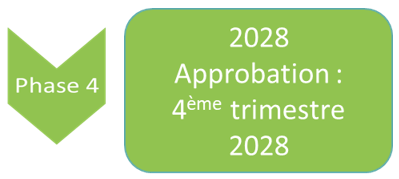
- Depuis l’arrêt à l’approbation du PLU
- Consultation des personnes publiques associées
- Enquête publique
- Formalisation du dossier d’approbation
Exposition en cours à la maison de la Terre de Peyre
Éviter — Réduire — Compenser
Une rencontre a eu lieu le 16 juin sur le thème de l’artificialisation des sols, à la mairie de Peyre en Aubrac, entre les élus de la commune et le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) autour de l’exposition « éviter, réduire, compenser » créée pour le séminaire foncier de Mende.
Madame Baudin du CAUE a commenté les panneaux qui ont pour but de montrer que la protection des sols naturels peut également se faire en milieu rural et retracent des exemples de réalisations lozériennes.
Cette exposition est installée jusqu’à la fin du mois de septembre dans le hall de la mairie de Peyre en Aubrac et cela coïncide avec le lancement de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Nous vous invitons à venir nombreux la découvrir.
La démarche n’est pas simple, mais elle doit avancer tout doucement dans l’esprit des gens et la municipalité souhaiterait que les habitants se saisissent de l’occasion pour s’informer, et s’intéresser à ce sujet qui sera au centre des débats dans les prochains mois, lors des travaux du PLU.
Sujet délicat et compliqué, mais tellement important pour les générations futures !
C’est quoi l’artificialisation des sols ?
Transformation d’un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Ce changement d’usage des sols, le plus souvent irréversible, a des conséquences qui peuvent être préjudiciables à l’environnement et à la production agricole.
L’artificialisation résulte de l’urbanisation et de l’expansion des infrastructures, sous l’influence de la dynamique démographique et du développement économique. Les surfaces artificialisées regroupent l’habitat et les espaces verts associés, les zones industrielles et commerciales, les équipements sportifs ou de loisirs, les réseaux de transport, les parkings ou encore les mines, décharges et chantiers.
L’artificialisation des sols, et notamment leur imperméabilisation, amplifie le ruissellement de l’eau au détriment de son infiltration, et participe ainsi à l’érosion des sols, est à l’origine de coulées d’eau boueuse et accentue le risque d’inondation. Le ruissellement contribue également à la dégradation de la qualité chimique et écologique des eaux en intensifiant le transfert de sédiments chargés de contaminants des sols vers les cours d’eau (engrais azotés ou phosphatés, hydrocarbures, métaux lourds, produits phytosanitaires). L’artificialisation des sols peut aussi provoquer un déstockage de carbone rapide et conséquent, qui contribue au changement climatique lorsque le sol n’est pas très vite couvert (végétation, revêtement). Enfin, elle affecte la biodiversité en fragmentant les habitats naturels et en transformant irrémédiablement les écosystèmes et les paysages.
Depuis 1950 nous avons perdu, au niveau national, 30 % des surfaces agricoles en France.
*****
Déposer une observation ou une demande concernant le Plan Local d’Urbanisme
Élaboration du Plan Local d'Urbanisme – Recueil des remarques
Pour poser vos questions ou proposer une idée qui ne concerne que vous, c’est ici ! Ce formulaire est dédié aux personnes qui s’interrogent sur l’avenir de leur parcelle, la constructibilité de leur terrain ou qui souhaitent enrichir le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une proposition.« * » indique les champs nécessaires